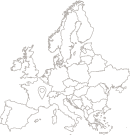Les axes de recherche
Le laboratoire junior GRAPHÉ (Groupement de Recherche sur l’Action Philologique et Humaine au prisme Épistémologique) a été fondé à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne en 2024. Profondément interdisciplinaire, il vise à analyser les conditions de possibilité des langages à produire l’action et à prendre sens dans l’action. Interroger les outils qui permettent d’étudier les langages est également au cœur de ses préoccupations.
Axe A – Langage et image, langage de l’image, langage imagé.
L’image, en tant qu’objet d’art, possède son propre langage, structuré par des règles spécifiques. Néanmoins, étant libérée des règles de syntaxe, l’image permet une liberté de lecture plus étendue et différentes strates d’appréhension. Elle constitue ainsi une matière malléable qui peut être saisie pour diverses finalités. Si l’image est parfois employée en support d’autres formes de langage pour rendre un discours plus intelligible, dans un cadre quotidien et apolitique, elle peut également être saisie à des fins politiques (discours propagandiste) ou commerciales (discours publicitaire) et devenir une arme au service de l’action humaine sur le réel. La compréhension du langage de l’image ouvre ainsi une réflexion sur l’utilisation de ce dernier dans les contextes de pouvoir, et sur son exploitation par l’Homme pour agir sur la société dans laquelle il évolue.
Axe B – Reconstruire les rapports de force dans les sources historiques.
Le développement de la pragmatique linguistique a mis en lumière la manière dont le langage se faisait vecteur de rapports de force et dont il était employé pour agir sur le réel. Néanmoins, l’étude de ces modalités dans les sources historiques se heurte à des difficultés méthodologiques : le caractère nécessairement fragmentaire des sources, tant par leur nombre que par le point de vue qu’elles transmettent, et l’absence de sources autres qu’écrites invitent le chercheur à développer de nouveaux outils pour appréhender les rapports de force de ces époques à partir de ces sources. Il convient ainsi de s’interroger sur les méthodes de la pragmatique historique et des approches micro-pragmatiques. Il s’agit également de porter un nouveau regard sur des périodes où le langage n’est pas réellement théorisé au prisme de l’action sur le monde, par exemple l’Antiquité, pour en éclairer les textes.
Axe C – Manipulations littéraires et artistiques.
Dans les arts, le langage doit être envisagé avec un recul critique, d’abord parce qu’il est le véhicule d’une subjectivité, relayant une certaine vision du monde – à dessein ou non –, mais également parce qu’il intègre une manipulation créative : l’artiste peut utiliser le langage pour influencer le lecteur/spectateur et infléchir sa compréhension du monde. L’étude de l’implication des auteurs dans leurs œuvres permet également d’appréhender leur pensée sur le monde qui leur est contemporain et leur réappropriation de ce dernier via l’écriture. Cette réflexion interroge ainsi la toute-puissance dont bénéficierait l’auteur dans son œuvre grâce au langage, et l’efficacité de cette manipulation auctoriale sur le lecteur/spectateur.
Axe D – Langage et pouvoir au prisme des NLP.
Le domaine des NLP (Natural Language Processing) a connu un essor sans précédent ces dernières années, et ses applications pratiques se sont multipliées (intelligence artificielle, traducteurs automatiques, chatbot…). Cette percée n’est néanmoins pas sans soulever de nouveaux défis : le langage naturel est par essence ambigu, inclut des réflexions sur le monde, et ne peut souvent être compris que dans le contexte social dans lequel il prend place. Que l’on pense par exemple à l’ironie, aux références culturelles partagées par les interlocuteurs, ou à l’humour. Alors que les technologies reposant sur le traitement du langage ont de plus en plus vocation à intégrer le système social et à y jouer un rôle, il convient de s’interroger sur la manière dont ces dernières peuvent incorporer les réalités sociales à leur compréhension du langage et dont elles peuvent à leur tour agir sur ces réalités.