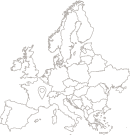[IHRIM] - Colloque international « L’altérité du passé. Consciences d’époque et jugements de valeur (XVIIe-XIXe siècle) »
Du 21 janvier 2026 au 23 janvier 2026
Université Jean Monnet Saint-Étienne - Campus Manufacture - CSI Bâtiment Les Forges
11 rue Dr Rémy Annino - 42000 Saint-Étienne - Salle L020
Événement organisé par Delphine Reguig (UJM Saint-Étienne, IHRIM, IUF) et Stéphane Zékian (CNRS-IHRIM)
Appel à communication
- Depuis plusieurs années, de nombreuses controverses mettent en lumière les difficultés de notre présent à envisager sereinement certaines œuvres ou productions culturelles du passé. Une virulence parfois extrême caractérise ces controverses. À première vue, deux blocs semblent se faire face : le premier prône l’adaptation, la réécriture voire la destruction de ces productions, arguant du caractère désormais inassimilable des traces laissées par un âge périmé de la pensée comme de la conscience humaines ; le second, au contraire, plaide pour une meilleure prise en compte de la différence des temps ; il souligne aussi l’importance primordiale d’une approche esthétique des œuvres incriminées. Chacun crie au scandale et renvoie l’adversaire à son aveuglement idéologique : on dénonce, d’un côté, une idéologie « bien-pensante » qui appellerait à vandaliser le legs du passé, de l’autre, une crispation « réactionnaire » qui masquerait son adhésion aux pires dérives sous le paravent de la vénération patrimoniale. Paradoxalement, la conviction de vivre un moment de bascule fédère les antagonistes. Les uns pensent sortir enfin d’un âge obscur quand les autres redoutent d’y entrer. Mais dans tous les cas, il paraît entendu que nous vivons un moment inouï.
Fondé sur l’hypothèse inverse, ce colloque voudrait montrer que la connaissance des pratiques anciennes jette un éclairage utile sur les lignes de fracture contemporaines, et qu’elle permet de mieux évaluer ce qui fait réellement rupture dans les luttes actuelles. Replacer notre actualité dans un temps relativement long devrait aider, d’une part, à cerner les raisons pour lesquelles, dans certains contextes critiques, on ne tolère plus qu’un passé-miroir, éloge ou justification de notre propre présent, d’autre part, à exhumer les soubassements de pratiques mémorielles dont le caractère sélectif a parfois tout d’une cécité volontaire.
En conséquence, ce colloque propose d’examiner, dans des conjonctures variées s’échelonnant sur environ 250 ans, les modes d’appréhension par les vivants d’un passé jugé par eux problématique. Si chaque conscience d’époque cristallise dans les jugements de valeur portés sur les productions du passé, sur quelles décisions pratiques ont débouché ces jugements depuis le XVIIe siècle ? Nous souhaitons analyser les enjeux et les implications des gestes intellectuels et matériels qui, en sanctionnant l’altérité du passé, scindent autoritairement l’histoire entre ce qui parle encore au présent et ce qui, à l’inverse, ne le regarde plus – ou seulement de loin. Nous nous attacherons aux différents types d’opérations renvoyant les productions culturelles dans le passé, sous le signe d’une étrangeté qui peut être, ou non, valorisée en tant que telle. « Le passé » ne répond en effet a priori à aucun critère chronologique ni axiologique stable : il apparaît toujours comme le produit mental d’une conjoncture qui catégorise ainsi le socle de l’expérience à la fois transmise et vécue, et lui accorde une valeur que les rapports de force et les besoins symboliques du moment soumettent à variations. Le sentiment d’éloignement que nous pouvons éprouver à l’égard de certaines époques historiques étant dissocié de la mesure chronologique objective, le singulier de ce que nous nommons le passé a lui-même tout d’une illusion : pour faire droit à la simultanéité des non-contemporains théorisée par plusieurs penseurs allemands de la première moitié du XXe siècle, et, plus généralement, au feuilletage des expériences temporelles composant toute conscience d’époque, nous nous interrogerons à la fois sur les processus de délimitation du passé (quand s’arrête-t-il, quand commence notre présent ?) et sur les logiques présidant à son évaluation (que vaut-il encore pour nous, qu’avons-nous à y chercher ?). Une attention spéciale sera portée aux étiquettes et autres catégories dont la portée descriptive s’est longtemps doublée d’une fonction normative. Parmi elles, les dénominations d’« ancien » et de « moderne » sont les noms disponibles et de fait toujours réinvestis de fonctions variées (de démarcation, d’auto-identification, de rejet) qui, au moins depuis le XVIIe siècle, ont perduré jusqu’à nous.
Télécharger l'appel à communication dans son intégralité
CONDITIONS DE CANDIDATURE
- Les propositions sont à envoyer avant le 15 juin 2025 conjointement à :
delphine.reguig @ univ-st-etienne.fr
stephane.zekian @ gmail.com