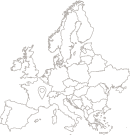Mathilde BertrandPhysiologiste du sport
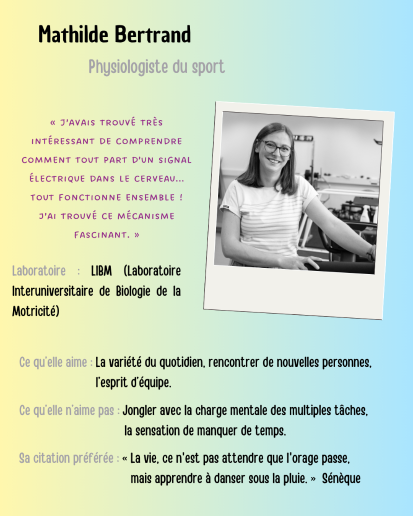
Personnaliser l’activité physique permet-il de diminuer la fatigue chronique ?
C’est la question qui préoccupe Mathilde depuis bientôt trois ans, dans le cadre de sa thèse en Motricité Humaine et Handicap.
La fatigue chronique peut se manifester dans des cas très divers, sans être liée à une pathologie unique. On la retrouve dans les cancers, les maladies inflammatoires et auto-immunes, la sclérose en plaques, le COVID long, l’encéphalomyélite myalgique…
C’est pourquoi, contrairement à ce qui est généralement fait dans les essais cliniques, Mathilde a fait le choix de considérer la fatigue chronique en elle-même, sans distinction de maladie.
L’objectif de sa thèse est double : bien évaluer la fatigue chronique pour mieux la comprendre, et étudier l’effet de la personnalisation de l’activité physique prescrite aux personnes atteintes de fatigue chronique.
Pour cela, Mathilde compare deux groupes, qui pratiquent une activité physique trois fois par semaine durant 3 mois. Le premier groupe suit un programme d’activité physique standard, tandis que le second suit un programme adapté chaque semaine en fonction de la fatigue ressentie.
Mathilde étudie notamment ce qu’il se passe au niveau neuro-musculaire (de l’émission du signal par le cortex moteur du cerveau jusqu’à la réalisation du mouvement par les muscles), en utilisant diverses méthodes de stimulation, comme la stimulation électrique.
Parcours
Au collège, Mathilde ne sait pas encore qu’elle entrera dans le monde de la recherche quelques années plus tard.
De professeure de français à professeure de SVT, Mathilde s’imagine dans un premier temps enseignante.
Fille de parents tous deux issus du domaine médical, elle s’intéresse ensuite, durant son lycée, aux études de médecine, mais l’enseignement reste une option. Elle se penche alors sur le cursus STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), qui lui permettrait d’enseigner l’EPS (Education Physique et Sportive).
Finalement, c’est la voie de la licence STAPS qui séduit Mathilde à la sortie de son bac scientifique. Et au premier cours magistral de physiologie auquel elle assiste, elle découvre le métier d’enseignant-chercheur et comprend qu’elle est attirée par la recherche. Cet enseignant qui lui ouvre la voie deviendra d’ailleurs l’un de ses encadrants de thèse quelques années plus tard, après l’avoir accompagnée sur des stages en L3 « Activité Physique Adaptée et Santé » puis en master « Entraînement et optimisation de la performance sportive ».
« C’est cet enseignant qui m’a tirée tout le long avec lui. On a créé ensemble le parcours de doctorat qui a été le mien. »
Grâce à ces différents stages et à cet enseignant, Mathilde connaît déjà le monde de la recherche au moment où elle entre en thèse, et n’est donc pas surprise par les contraintes qui accompagnent le métier de chercheur, comme par exemple les déplacements pour trouver un post-doctorat.
« Il m’a intégrée dès mon stage de L3 dans des projets de recherche, et m’a sensibilisée au fait que quand on est chercheur, il faut bouger. Beaucoup de mes collègues ont été surpris de cet aspect, là où moi je n’ai pas eu de surprises. Je le remercie pour ça ! »
Cependant, même si elle y est préparée, la perspective de devoir bouger n’est pas forcément désirable pour Mathilde. Mais la diversité du quotidien vaut le coup.
« Le quotidien change beaucoup, certains jours on est avec les patients, le lendemain c’est de l’analyse de données, un autre jour on fait de la rédaction… Et c’est encore plus varié si l’on est associé à plusieurs projets. On peut même varier les thématiques de recherche en transposant nos compétences. »
Quand on lui demande pourquoi cet intérêt pour le domaine neuro-musculaire, Mathilde cite ses premiers cours de physiologie :
« J’avais trouvé ça très intéressant de comprendre comment tout part d’un signal électrique dans le cerveau qui peut faire contracter n’importe quel muscle dans le corps. Tout fonctionne ensemble, les muscles, les cellules… j’ai trouvé ce mécanisme fascinant. »
Vivre la recherche
Après trois ans plongée dans la recherche, Mathilde dégage sans peine les aspects positifs qui lui plaisent dans ce milieu. Le fort esprit d’équipe, où les membres sont soudés et se dynamisent mutuellement, et le contact avec une grande diversité de personnes (médecins, patients, techniciens…), sont très enrichissants.
Parallèlement, certains aspects sont parfois moins plaisants : la diversité des tâches signifie aussi une multitude de choses qui doivent être pensées et suivies, avec un rythme très soutenu.
« Je pense que c’est facile de tomber dans du surmenage. On a tout le temps envie de faire plus, de bien faire, et on n’a pas de moments de pause après la fin d’une partie. »
Parmi ces différentes tâches, les activités d’enseignement sont aussi autant de moments chronophages qui ralentissent la recherche, même si elles sont elles aussi très enrichissantes et partie intégrante du métier d’enseignant-chercheur.
Suite à cette thèse, Mathilde se dirige vers un post-doctorat. Plusieurs pistes s’ouvrent à elle, dans différentes thématiques de recherche et destinations possibles, avec une petite attirance pour la Suisse et l’Angleterre !